SPOILERS
Ce devait être le gros film évènement de l’année à égalité avec le troisième et dernier opus de la trilogie « Batman » de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. C’était aussi le grand film mystère de 2012 tant il était impossible de prévoir ce qu’il y aurait dedans. Il n’était d’abord qu’un simple Alien 5 avant de devenir par la suite un Alien 0 devant se dérouler avant le premier épisode et lever le mystère sur le Derelict, le mystérieux vaisseau extraterrestre qui s’était écrasé sur la planète LV-426, et son immense occupant, le Space Jockey, créature gigantesque fossilisée qui faisait apparemment corps avec le siège sur lequel elle se trouvait et dont la poitrine avait été perforée. Qu’est-ce qui lui était sorti de la cage thoracique ? Qui avait pondu ces millions d’œufs dans la soute ? En gros, comment l’abominable xénomorphe était-il né et comment avait-il décimé l’équipage de ce vaisseau venu d’un autre monde ?
Le dernier film de Ridley Scott découlait de ce projet et se démarquait soi-disant de la franchise Alien en se faisant d’abord appeler Paradise puis Prometheus. Selon les dires du réalisateur, il s’agissait d’un film de S.F. autonome qui se déroulait bien dans l’univers d’Alien sans pour autant faire apparaitre la fameuse créature. Non, ô grand jamais, Scott ne sabordera la mythologie qu’il avait brillamment initié en 1979. C’était avant tout une histoire sombre et indépendante sur l’origine de l’Humanité qui était née du travail préparatoire pour cette prequel désormais mise à la poubelle. Ridley Scott le jurait sur tous les toits : il avait retrouvé la pêche après vingt-cinq années d’errance artistique où le metteur en scène avait payé ses deux chef d’œuvres futuristes trop précoces, Alien et Blade Runner, en enquillant les projets plus ridicules et insipides les uns que les autres. A l’exception d’un Gladiator salutaire (bien que Scott n’ait jamais digéré de ne pas avoir obtenu l’oscar du meilleur réalisateur par la même occasion), le Ridley Scott d’il y a vingt ans était bien mort pour laisser à sa place un obscur sosie éponyme ayant enchainé quelques navets aux budgets indécents par rapport aux résultats à l’écran.
 Alien Résurrection
Alien Résurrection
En effet, là où les producteurs avaient tenté de mettre de la poudre aux yeux des fans « hardcore » de la série Alien en faisant revenir son instigateur, leur faisant ainsi croire que Prometheus allait remettre la saga sur le droit chemin après les accablants Alien Résurrection et Alien vs. Predator, une partie des cinéphiles ne pouvait s’empêcher d’être très méfiante en voyant l’arrivée sur le projet d’un homme ayant enchainé le pro-interventionniste La Chute du Faucon Noir, le grotesque Hannibal, le soporifique et pompeux Kingdom of Heaven, le lénifiant Mensonge d’Etat (Scott, en vraie girouette opportuniste, signait cette fois un film « démocrate »), l’embarrassant Une Grande Année et le complètement lamentable Robin des bois « begins » à 200 millions de dollars de budget.
Pourtant l’espoir avait fini par naître tant Ridley Scott semblait être sincère dans ses propos : « un film de « dark S.F. » au « discours philosophique ambitieux » tout en ayant une direction artistique phénoménale et une échelle épique à en faire trembler l’immense Avatar de James Cameron. Les bandes annonces et la titanesque campagne de promotion firent parfaitement leur boulot en vendant un film de science-fiction comme on en a qu’un toutes les décennies. Certains se mettaient à fantasmer en envisageant Prometheus comme le plus grand film de S.F. depuis Blade Runner. Un « space opera » en plus, trois déifié pour nous plonger dans l’immensité intersidérale, nous faire côtoyer des vaisseaux spatiaux et nous permettre de visiter des monuments extraterrestres de toute beauté comme si on y était !
Sauf que cette campagne marketing instaura dans le même temps un doute. Prometheus n’est-il vraiment pas lié à Alien comme s’évertuent de le faire croire Scott et ses producteurs ? Cette alarme qui retentit dans les divers « teasers » n’est-elle pas celle qui rendit célèbre la première bande annonce d’Alien ? Et cette typographie et la façon dont apparait le titre du film n’est-elle pas la même que celles d’Alien ? Et ces décors semblant ressortir tout droit des artworks non utilisés pour le premier épisode, tout en recyclant ceux déjà faits dans les autres longs-métrages de la saga ? Et que vient faire le Space Jockey si le film n’a presqu’aucun rapport avec le film de 1979 ? Et pourquoi chacune des scènes entraperçues dans la BA de Prometheus renvoie automatiquement à une séquence ou une idée du premier épisode ? Le lien, l’ADN d’Alien ne serait pourtant perceptible qu’au cours des huit dernières minutes. De deux choses l’une, soit la BA a dévoilé complètement ces huit minutes, soit le projet est bien plus mensonger qu’il voulait le faire paraitre.
 Cycle de la vie
Cycle de la vie
Le mystère restait néanmoins entier avant l’entrée en salles et le bénéfice du doute était toujours permit. Après tout, c’était bien la première fois depuis longtemps qu’un film de Ridley Scott donnait vraiment envie et était la promesse d’un blockbuster de haut standing. La France en ayant quasiment eu l’exclusivité, la plupart des critiques nationales se firent plutôt convaincues par l’affaire ; il y avait en tout cas un nombre étonnement élevé d’avis positifs au sujet d’un film de S.F., genre qui n’est pourtant pas le plus populaire aux yeux de l’élite culturelle française. Hors les deux premières minutes d’introduction vont remettre très vite les pendules à l’heure, rappelant bien qui est malheureusement à la barre du projet. Au milieu d’un paysage dévasté où des torrents d’eau lézardent une terre grise encore sans vie, un être encapuchonné tel un chevalier Jedi admire une soucoupe volante bruyante. Otant ses habits, on découvre avec stupeur une sorte de nageur albinos géant bodybuildé en pagne qui, après avoir bu une décoction particulière, se décomposent en poussant de grands rugissements avant de sombrer dans l’eau tourbillonnante où son ADN se dissout avant de se reformer pour former de nouvelles cellules et créer ainsi la vie sur Terre.
Effectivement, on est à des années lumières d’Alien. Mais du coup, point de suspense sur l’apparence de nos créateurs extraterrestres ni même sur la viabilité de la théorie des deux héros à l’origine du long voyage du « Prometheus ». Tant pis. Mais il s’agit-là d’une entrée en matière pour le moins surprenante. Les vingt-cinq premières minutes ont même plutôt tendance à rassurer par leur tenue. Attention il n’y a rien de très novateur puisqu’il s’agit à peu près d’une redite de la première demi-heure d’Alien le huitième passager : un équipage se réveille dans l’espace après un long hyper-sommeil lorsque leur vaisseau s’approche d’une planète inconnue ; ils y atterrissent et découvrent immédiatement (par le plus grand des hasards cette fois) une structure architecturale vraisemblablement extraterrestre qu’ils s’emploient à explorer avant de découvrir un nid d’amphores cylindriques (très certainement des œufs alien dans une version antérieure du script) aux contenus dangereux.
Rien de bien neuf sous le soleil si ce n’est que les effets spéciaux ont fait un réel bond en avant pendant ces trente années. On ne peut clairement pas enlever à la direction artistique d’être absolument magnifique. Si ce n’est que tous ces couloirs et designs ont déjà été vu au cours de la quadrilogie Alien et que la plupart de ces décors ne sont qu’un recyclage des dessins préparatoires de Giger ainsi que des illustrations de « Metal Hurlant ». Mais soit, ça reste joli à regarder. Cependant quelques scories viennent déjà gâcher ces vingt-cinq minutes de découvertes. D’abord une apparition toute sauf réussie du personnage de Peter Weyland, fondateur de la fameuse compagnie « Weyland-Industries » qui souhaitait récupérer le xénomorphe pour en faire une arme, capture pouvant se faire au détriment de l’équipage qu’elle envoyait pour le ramener. Ce personnage de plus d’une centaine d’années, refusant de mourir comme un roi et s’évertuant à repousser sa mort inévitable par sa fortune incommensurable, est l’instigateur de cette expédition visant à découvrir les créateurs de l’Humanité dans le but que ces derniers acceptent de rendre immortel leurs créations (il est le pendant humain de Roy Batty dans Blade Runner qui cherchait lui-aussi à allonger son espérance de vie en partant à la rencontre de son « fabriquant » pour que celui-ci repousse sa date terminale). Mais ce personnage qui n’apparait jamais autrement que sous l’apparence d’un vieillard est interprété par le « jeune » Guy Pearce affublé ainsi d’un grotesque maquillage.
 Morcellement
Morcellement
D’autres faiblesses sont bien plus dommageables puisqu’elles viennent directement du script. Celui-ci, comme nous allons le voir, est le point faible principal de Prometheus, à tel point qu’il est très difficile d’en faire abstraction pour ne voir que le « bon côté » des choses. Rarement on a vu dans un blockbuster une écriture aussi aberrante des personnages ; pourtant on a été plutôt servi depuis quelques mois au niveau des films à gros budget mal écrits. Mais là où on n’attend pas grand-chose à la base d’un Men in Black 3, d’autant plus si l’on est au courant de la production chaotique dont le film était victime, d’un Sherlock Holmes 2 ou encore d’un long-métrage tel que La Colère des Titans, un film comme Prometheus n’a pas le droit à ce genre d’erreurs. Car on place de plus grandes espérances en lui, et ce n’est pas sans être la faute d’une campagne marketing vantant un nouveau chef d’œuvre ou les propos pompiers et prétentieux de son metteur en scène.
Hors l’équipage de ce « Prometheus » est un groupe de bras cassés, pour ne pas dire autre chose et éviter d’être vulgaire. Rarement dans l’histoire de la science-fiction aura-t-on vu équipe de scientifiques aussi peu crédible. Quelle bonne idée en effet de partir en première expédition sans même être muni d’un quelconque moyen de défense en cas de mauvaise surprise ! C’est sûr, pour Hollywood, être scientifique signifie toujours au minimum d’être un pacifiste aveugle et new age (« tout n’est que paix et amour »). Evidemment lorsque les choses ne tournent pas à leur avantage, ils finissent par bêtement s’en mordre les doigts (et le spectateur est censé éprouver de la crainte pour eux). A peine les astronautes repèrent-ils que l’air est apparemment respirable qu’ils enlèvent immédiatement leurs casques sans apparemment envisager une seule seconde la possibilité d’infections mortels inconnues que leurs équipements terriens ne pourraient pas détecter. Et c’est sans compter David l’androïde qui, sous prétexte d’avoir passé deux ans à décortiquer les langues antiques pour trouver un « langage originel », ce qui ne devrait en plus que fonctionner en théorie, arrive à comprendre en dix secondes n’importe quel signe ou bouton alien. Jamais l’équipe ne se retrouvera bloquée ou arrêtée.
A sa décharge, David a le droit à la meilleure séquence du film lorsqu’il parcourt tout seul le vaisseau pendant toute la durée de ce voyage de près de deux ans. Une séquence calme presque contemplative qui amène le spectateur à croire qu’il est sur le point de regarder un grand film de S.F. avec quelques interrogations métaphysique passionnantes notamment liées à la vie artificielle. Par intermittence, on peut aussi féliciter l’équipe des effets spéciaux qui livre véritablement des plans d’ensembles sublimes, que ce soit dans l’espace ou à l’approche de la planète. Bien qu’encore une fois James Cameron était arrivé bien à l’avance en introduisant Avatar par une scène similaire à laquelle il est parfois difficile de ne pas penser. L’intérieur du dôme est nettement moins novateur bien qu’on puisse encore saluer l’équipe de tournage qui a eu le courage de reproduire réellement des décors gigantesques dans les célébrissimes studios Pinewood.
 Incohérences
Incohérences
Mais la comparaison avec Alien fait très mal, ne serait-ce que par la simple caractérisation de l’équipe. D’abord Prometheus possède le double de personnages que le film de 1979, un nombre élevé pourtant bien dispensable vu que seuls sept ou huit d’entre eux apparaissent véritablement de façon récurrente. Les autres se contentent de faire de la figuration ou d’avoir quelques répliques bien dispensables. Mais là où le bât blesse vraiment c’est dans la cohérence de ces personnages et des ficelles scénaristiques. Dans le premier Alien, l’équipage pouvait être amené à faire quelques erreurs, quoiqu’elles se comptent sur les doigts d’une main. Elles pouvaient s’expliquer par le caractère exceptionnel de la situation face à laquelle ces personnages étaient confrontés mais aussi par le simple fait de leur profession. Ce n’étaient que des pilotes-ouvriers d’une cargaison commerciale.
Mais des erreurs de comportement sont nettement moins pardonnables quand l’équipe en question n’est autre que l’élite scientifique de l’humanité devant être préparée à de tels expéditions et étant obligée de suivre un protocole drastique afin de garantir leur sécurité. On ne peut qu’être ébahi devant l’incompétence et la crétinerie intersidérale de ces savants. D’abord ils ne sont même pas au courant de la mission et sont ainsi partis pour un voyage de quatre ans (aller et retour) sans même savoir dans quel but (outre le fait qu’une expédition pareille aurait bien eu du mal à ne pas être ébruitée). Mais pour le coup, Scott et Lindelof sont suffisamment malins et roublards pour faire une ellipse au moment opportun, évitant ainsi d’avoir à expliquer cela.
Pour bien dévoiler le sérieux de ce script, suivons le personnage de Fifield, géologue punk et tatoué. Il accompagne le premier groupe d’expédition dans le dôme extraterrestre et, une fois entré à l’intérieur, active une poignée de robots-scanner sphériques afin d’établir une carte en trois dimensions des lieux. Ajoutons à cela qu’il a visiblement un écran sur son bras qui lui permet de voir l’avancée de ce scanner, qui prendra plusieurs heures tant cette structure complexe est gigantesque, et guide ainsi le reste de l’équipe (il dit « mes louveteaux me disent d’aller par là », ponctué d’un hurlement à la mort digne d’un gamin). Maintenant que vous avec ces données en main, devinez qui va malgré tout se paumer sur le chemin du retour alors que le signal n’est pas encore brouillé et que le vaisseau « Prometheus » capte lui-aussi au même moment le scanner du dôme et la position des scientifiques à l’intérieur ?
 Infantile
Infantile
Malheureusement ce n’est pas tout. Revenons un peu en arrière pour connaître les motivations de Fifield de soudainement quitter le groupe et se paumer comme une andouille sans raison apparente. Effrayé par une apparition holographique dont l’utilité scénaristique n’est autre que gratuite afin de dévoiler un évènement sur lequel on n’aura aucune explication au final, Fifield refuse de suivre le groupe qui cherche à entrer dans une salle fermée. La raison de sa soudaine panique ? Il pète les plombs d’un coup en voyant un cadavre décapité de Space Jockey. Outre le fait que la réaction soit saugrenue sachant la direction de son voyage (l’espace intersidéral) et sa situation actuelle (une construction architecturale sur une planète lointaine qui doit bien sa fondation par une créature d’un autre monde), il décide malgré tout de se séparer du groupe.
Sachant que le corps décapité ne bougera pas et qu’il se trouve en plein milieu devant cette porte qui finit par être ouverte par le reste du groupe, devinez dans quel endroit Fifield et le camarade effrayé qui l’a suivi vont se réfugier une fois qu’ils se retrouvent tout seuls dans cette grotte de plusieurs dizaine de kilomètres ? Bingo ! Dans la salle même dans laquelle il ne voulait pas entrer. Continuons encore un peu. Fifield et son ami sont visiblement terrorisés par la moindre possibilité de vie extraterrestre, même morte depuis deux milles ans. Une séquence les montre d’ailleurs pris de panique lorsque le pilote du « Prometheus » les alerte qu’une des sondes a remarqué une forme de vie qui a fini par disparaitre (autre incohérence, celle-ci est en faite bloquée devant une porte ; on ignore comment elle a repéré une forme de vie au travers sachant qu’il s’agit d’un Space Jockey endormi qui ne bouge pas de son caisson depuis deux millénaires). Que va faire le duo de « sérieux scientifiques » lorsque ceux-ci tomberont nez-à-nez avec une sorte de cobra extraterrestre vivant ? Ils vont jouer avec comme si c’était un chat et essayent de le caresser en riant. Logique. Et pour Mr Ridley Scott il apparaitrait comme normal que l’on éprouve de l’empathie ou de l’inquiétude au sujet de ces deux incapables décérébrés qui se font éliminer de la plus horrible mais aussi de la plus sotte des manières.
Et c’est comme ça tout le temps. Le pilote s’aperçoit qu’une sonde repère une forme de vie intermittente ? Sûrement un bogue dont il ne faut strictement pas s’inquiéter. Ces deux collègues sont coincés toute une nuit dans un dôme alien ? Il quitte son poste d’où il peut les contacter et surveiller la carte en trois dimensions du dôme pour aller coucher avec sa supérieure qui lui fait des « avances ». Sans prendre la peine de faire appel à un remplaçant pour surveiller ; et c’est pourtant pas faute d’avoir augmenté l’équipage par rapport au premier épisode. Inutile de dire qu’un James Cameron s’était beaucoup mieux débrouillé avec un nombre similaire de personnages dans Aliens tout en réussissant à leur donner un comportement cohérent (ces marines sont bien plus prudents et malins que ces scientifiques censés avoir plusieurs années d’étude). L’un des membres de ce corps scientifique va jusqu’à ce saouler comme une adolescente dépressive parce qu’il a découvert des formes de vies extraterrestres décédés (mais il a quand même découvert l’existence d’une peuplade intersidérale intelligente et vu des choses que presqu’aucun homme ne verra). Non, ce n’est qu’un tombeau pense-t-il avant d’enquiller sur une nouvelle bouteille de vodka.
 Briser la suspension d’incrédulité
Briser la suspension d’incrédulité
Aucun protocole scientifique élémentaire n’est suivi. Il n’y a qu’à voir la consternante scène de l’étude de la tête du Space Jockey pour avoir du mal à se retenir de se cacher les yeux de honte après avoir assisté à une séquence pareille où l’incompétence de personnages est mise à ce point en exergue. Aucune précaution n’est prise, aucune réflexion préalable n’est faite. Non, on agit en dépit du bon sens et des risques et on observe ce qui se produit, généralement en se mordant les doigts. Même l’androïde David ne suit que trop bien son modèle humain en s’employant à quelques expériences à l’intérêt très relatif et dont la réussite dépend avant tout du plus pur des hasards. Les fans du film vous répondront qu’il ne fait qu’expérimenter ce qu’il découvre sans autre plan derrière la tête, ce qui veut donc dire qu’on accepte sans problème qu’il fasse n’importe quoi sans raison (mais qu’avait-il derrière la tête en plaçant une goutte de liquide noir dans le verre d’Holloway, petit ami de l’héroïne Elisabeth Shaw ? C’était juste pour faire mumuse ?!)
Si la première heure n’est pas très convaincante malgré quelques passages tape-à-l’œil aux effets spéciaux suffisamment hallucinants pour que le spectateur évite de trop se poser de questions sur le bazar scénaristique ambiant, la seconde fait preuve de tant d’audaces dans l’ellipse délirante et la torsion du concept de suspension d’incrédulité qu’on ne peut qu’en rester admiratif. Ridley Scott affirmait à qui voulait l’entendre que « sacrebleu, je ne fais aucune concession, fuck the producers, mon montage en salle sera MON director’s cut », il est quand même sacrément difficile de croire un seul instant que Prometheus n’ait pas été très sévèrement charcuté. Ou alors Scott n’est plus bon que pour la maison de retraite s’il est incapable de voir de telles incohérences scénaristiques et la non tenue de son script.
A partir de cette séquence nocturne déjà bien tarte qui se finit sur une scène choc qui peine à réveiller le spectateur qui n’y croit déjà presque plus, le long-métrage part strictement en roue libre. Là où l’illusion d’un film de S.F. « sérieux » perdurait encore, Prometheus se met soudain à ressembler à un bis italien à qui l’on aurait confié plusieurs millions de dollars. Un étrange décalage où une superproduction balance des actions et des réactions régulièrement grotesques avec un sérieux papal qui donne une folle envie de baffer toute l’équipe de tournage qui nous vomit sa prétention sans borne. Il est vrai que nous vivons désormais dans un monde qui considère que le meilleur blockbuster de 2011 n’est autre que le navrant La Planète des Singes - les origines. Comment alors condamner la scène de Prometheus où un scientifique découvre qu’il est infecté d’un mal extraterrestre mystérieux mais qui ne considère pas un seul instant la nécessité de prévenir son équipage de cette infection peut-être mortelle et contagieuse, sachant qu’une scène similaire se trouvait dans le film si acclamé de Rupert Wyatt qui voyait un savant mourir bêtement d’atroces souffrances sans qu’il n’ait considéré un seul instant à consulter un médecin ?
 Mutation
Mutation
Là où les incohérences scénaristiques fâcheuses apparaissaient de temps à autres dans la première heure, la seconde ne laisse aucun répit, faisant succéder à la réaction grotesque d’un personnage une nouvelle réaction encore plus aberrante. On pourrait presque finir par parler d’objet expérimental tant Prometheus essaye de ne pas placer un seul évènement crédible. A peine a-t-on le temps de digérer l’exécution du savant pestiféré acceptant de se sacrifier car la commandante du Prometheus refuse de lui donner accès au quartier de quarantaine (?!) que tout les autres scientifiques de l’expédition, qui ignorent la façon dont l’un d’entre eux a été contaminé et qui ont, comme lui, retiré leurs casques sous le dôme pour respirer à pleins poumons un air extraterrestre peut être vicié, sont acceptés à bord sans aucune condition.
On n’éprouve d’ailleurs aucune empathie pour le petit ami de l’héroïne qui se fait cramer au lance-flamme, les bras en croix. Certes, l’acteur Logan Marshall-Green joue comme un pied et son personnage est tellement mal écrit et consternant qu’on avait en fait qu’une seule envie, c’était de le voir mourir dans d’atroces souffrances. Mais quand même. D’ailleurs sa petite amie stérile (traumatisme lourdaud, grossièrement amené et faussement ironique pour justifier sa volonté de connaître à tout prix l’origine et la création de cette vie qu’elle ne peut donner et concevoir) ne semble pas être affectée outre mesure après son évanouissement. Il ne sera d’ailleurs par la suite mentionné qu’une fois dans tout le long-métrage. Comme elle a, fort heureusement pour David, couché avec son petit ami après sa contamination, elle se retrouve miraculeusement engrossée d’un fœtus étrange à croissance foutrement rapide. Mais on refuse de lui retirer cet étrange être à l’intérieur de son ventre car le Prometheus n’est pas équipé pour une telle opération.
Qu’à cela ne tienne, malgré qu’on lui ait administré un calmant, Shaw casse la figure à deux scientifiques anonymes avant de se ruer dans la cabine-canot de sauvetage de la commandante Meredith Vickers (qui est une femme rappelons-le) où elle avait vu un « médipod », une machine pouvant faire de façon autonome des opérations à cœur ouvert. Sauf que celui-ci n’est programmé que pour les hommes. Pour quelle raison la science médicale est-elle si peu au point par rapport au reste ? D’autant plus qu’un avortement ne parait pas être une opération inutile dans le cadre d’une expédition où les membres sont de sexes différents et où des coucheries ne peuvent être à exclure après un si long voyage. Mais passons.
 Naissance
Naissance
Si on n’est pas trop idiot, sachant que Vickers ne peut utiliser cette machine, on ne peut que définitivement deviner un twist, déjà bien prévisible, avec l’arrivée du vieux Weyland à bord. Pourquoi avoir caché sa présence aux scientifiques sachant qu’il finira par se montrer au grand jour ? Un nouveau mystère décidément bien mystérieux. Sauf que, vu la brutalité de la machine, il n’est pas certain que cet homme condamné à mourir dans les prochains jours puisse survivre à une quelconque opération faite par ce médipod. Bien que Shaw se fasse une césarienne plutôt qu’un avortement plus adapté, elle semble subir une opération avec une anesthésie très relative et est recousue à l’arrache par un « pistolet-agrafes ».
On l’a bien compris, il s’agit de la scène choc de Prometheus. L’alien n’étant pas là pour exploser les cages thoraciques à grands renforts de jets de sang, Scott s’est débrouillé pour en réaliser une version alternative. Une séquence particulièrement réussie, poisseuse et claustrophobe bien que l’on puisse regretter que la majorité du gore de cette scène ait été rajouté en post-production afin de pouvoir être effacée si la Fox obligeait soudain l’impétueux Scott à se taire et à sortir une version « PG-13 ». On pourra aussi regretter que l’opération ait lieu trois minutes à peine après l’annonce de la grossesse de Shaw, là où un Cronenberg cradingue des années 80 n’aurait clairement pas hésité à jouer sur cette psychose du parasite vivant sous la peau.
Malheureusement, si prise indépendamment la séquence du médipod est clairement une des meilleures scènes qu’ait réalisé Ridley Scott en vingt ans, la séquence ne fonctionne pas dans son ensemble. Shaw assomme deux savants et personne ne part à sa recherche ou ne remarque que quelque chose ne va pas. Elle a le droit à plus d’un quart d‘heure de tranquillité alors qu’elle fait un bruit pas possible et qu’elle se trouve quand même dans les quartiers de la chef du vaisseau. Elle se retire une sorte de poulpe du bide, auquel elle envoie un jet stérilisateur comme si ça allait la tuer, et n’en parlera pas à son équipage. Rien. Pas un mot sur les trente minutes restantes du long-métrage. Personne ne s’en rendra compte, pas même les membres de l’équipage devant lesquels elle tombera à genoux, dénudée et en sang.
 Réapparition
Réapparition
Immédiatement après, c’est-à-dire une à deux minutes après cette scène choc, est révélé en grande pompe le twist Weyland qui ne s’émeut pas avec David de la voir débouler avec une cicatrice abdominale récente et le corps taché d’hémoglobine. Comme si l’épisode de la césarienne n’avait pas eu lieu. « Allez, dit David, allons voir notre ultime créateur encore vivant ». « Super, répond Weyland, je n’attendais que ça pour qu’on me file l’immortalité. Vous venez Mlle Shaw ? ». « Euh, nous avons eu tort mais d’accord ». Ca gène visiblement Mlle Shaw de ne montrer ne serait-ce qu’une once de sensibilité à l’encontre du fait qu’elle ait vu son amoureux se faire incendier et qu’elle se soit arraché presqu’à vif un poulpe alien de l’abdomen.
On a longtemps craint en voyant les premières images que Shaw soit une « Ripley-like » : une femme en retrait qui finit par s’affirmer au fur et à mesure que progresse l’aventure. Elizabeth Shaw n’est pas une femme forte. Elle est l’inverse même de Ripley. Il s’agit d’un personnage sans personnalité, sans aucune autre volonté que d’avoir la réponse à sa foutue question, prête à suivre n’importe qui même si ceux-ci lui font les pires crasses. Elle n’éprouve aucune haine pour Vickers qui refuse son petit ami dans son vaisseau et lui envoie un bon coup de lance-flamme presque sans broncher. Elle accepte de suivre immédiatement David qui lui avoue qu’il a contaminé lui-même Holloway ; même si elle finit par y être obligée à cause des circonstances, Shaw ne daignera pas montrer un seul signe de rejet de sa part pour cette option. Elle ne fait que subir et n’est poussée que par un traumatisme infantile cliché : la mort de ses parents à cause de maladies qui fait très vaguement écho au décès de son petit ami comme le soulignera David pour donner une caution sérieuse au film (comment le sait-il ? tout simplement parce qu’on peut maintenant lire les rêves dans l’univers d’Alien…). Ellen Ripley n’aurait jamais agit de la manière dont agit Shaw. Bonne idée de scénario ? Même pas, puisqu’il est strictement impossible d’éprouver de l’empathie pour une femme si dénuée de volonté qu’elle traverse le film telle un être léthargique (et ce n’est pas faute de Noomi Rapace d’essayer de relever le niveau). Une question peut d’ailleurs se poser : l’intérêt de la série d’Alien ne résidait-il pas plus dans le parcours de cette héroïne forte que dans les apparitions de son antagoniste ? Dans ce cas, comment se plonger dans Prometheus si son héroïne est d’une fadeur et d’une mollesse aussi déconcertante ?
Deux minutes après la découverte de la présence de Weyland dans le Prometheus, voilà t’y pas que Fifield réapparait. Et oui, l’équipage n’ayant retrouvé que son comparse décédé, ils n’ont pas essayé de retrouver l’autre ni même pris la peine de regarder ce que les caméras des combinaisons transmettaient. Ou alors elles se sont miraculeusement remises en marche pile au bon moment. Mais Fifield est devenu encore plus bête qu’avant après avoir plongé la tête la première dans cette substance noire dangereuse conservée dans les amphores et faisant muter tout ce qui y entre en contact (sans une réelle cohérence d’ailleurs). Là on se trouve face à un Fifield zombifié, contorsionniste et invincible qui fait « grrrr ! » dans la séquence qui remporte presqu’haut la main la palme de la scène la plus grotesque du long-métrage. On se croit alors dans une scène de film Z à peine digne ayant un seul but : dégarnir quelque peu les rangs de cet équipage trop nombreux. Ainsi des savants font leurs premières et dernières apparitions au cours de ces plans d’un dixième de seconde qui les voit mourir dans d’atroces souffrances. Une séquence complètement inutile dans la narration puisqu’encore une fois, on ne reviendra jamais sur cet évènement. Mais ça fait quelques morts de plus pour permettre à Shaw de se retrouver toute seule à la fin comme Ripley dans Alien.
 Hubris
Hubris
Lindelof essaye vaguement de lancer quelques pistes encore mystérieuses sans jamais les exploiter ou ne faire plus que les mentionner. Ainsi donc, au détour d’un mot, on découvre que le personnage de Vickers (Charlize Theron, de loin dans le pire rôle de sa carrière) est la fille naturelle de Weyland. Il aurait été pertinent de jouer sur le fait qu’elle soit en permanente confrontation avec David, le « fils » que Weyland n’a jamais eu. En effet ce dernier est un robot voulant être humain tandis qu’elle est une humaine à l’apparence et l’expressivité d’un robot. Mais Lindelof ne s’y penche que lors d’une très courte scène de dialogue destinée à (encore) ajouter du mystère à toute cette intrigue mystérieuse déjà trop pleine de mystères.
Prometheus ne gagne jamais à se rattacher à la franchise Alien. Il est évident que Prometheus n’est pas dénué de questionnements qui auraient pu être pertinents et audacieux si le film s’était concentré sur David (excellent Michael Fassbender, terriblement touchant dans sa façon de croire jusqu’au bout à ce projet et il est bien le seul). Ce dernier est le reflet même de cette humanité cherchant pourquoi elle a été crée. Et lui, quelle réponse peut-il avoir ? Pourquoi les humains ont-ils voulu le créer ? « Parce qu’on le pouvait » lui répondra tout bêtement Holloway. Comme si la réponse à cette question ancestrale qui hante l’Humanité ne pouvait être que décevante. Et si les Space Jockey eux aussi nous avait crée que parce qu’ils le pouvaient et qu’ils avaient voulu se le prouver ? Quel scandale et quel choc cela représenterait pour nous. Mais ces idées ne sont qu’effleurée au détour d’un dialogue. Jamais plus.
Car les impératifs commerciaux ainsi que la nécessité de satisfaire la « fan-base » geek reprend toujours le dessus. Il faut enchainer de la pyrotechnie, du bruit, des effets spéciaux. Il faut de la destruction, de la violence, de l’impulsif et non de la réflexion. A peine réveille-t-on le dernier Space Jockey ayant survécu à cette mystérieuse catastrophe qui les a décimé il y a 2000 ans et pour laquelle on n’aura même pas le droit à l’ombre d’un début de semblant de réponse, que celui-ci se lève et explose la figure à tout le monde en grognant. C’est ballot. Voyager deux ans dans l’espace afin de rencontrer sa divinité créatrice pour tomber sur un bodybuilder albinos rageur qui devrait prochainement intégrer le casting d’Expendables 3. Vraiment ça valait le coup. Et Prometheus se rêve vraiment comme le « dark » 2001 - L’Odyssée de l’espace moderne ? Il va falloir revoir ses ambitions à la baisse messieurs Scott et Lindelof, car chatouiller le chef d’œuvre métaphysique de Kubrick n’est clairement pas dans vos compétences ni dans vos talents dont vous semblez pour le coup manquer cruellement.
 Trous noirs
Trous noirs
Le film ne fait déjà à ce moment-là plus du tout sens. Le pilote noir, non scientifique, explique à Shaw ce qu’il a découvert visiblement tout seul (on l’en félicite parce qu’on ne sait ni ne saura jamais comment il est parvenu à une telle conclusion) : cette base souterraine est une usine militaire et chimique d’armes de destruction massive. Pardon ? Mais pourrait-on savoir pourquoi Mr Lindelof ? Ah ! C’est purement gratuit afin de justifier que le Space Jockey albinos extermine tout l’équipage et parte ensuite démolir la Terre. Pourquoi pas. Bientôt les fans de Prometheus viendront nous expliquer qu’il s’agit en fait d’une métaphore pertinente sur l’échec irakien. Mais dans ce cas, sachant que cette planète ne serait pas vraiment la leur, pourquoi aucun Space Jockey n’est venu voir ce qui clochait sur celle-ci puisque personne ne répondait depuis près de deux millénaires ? Pourquoi n’ont-ils pas envoyé depuis des Space Jockeys pour nous éliminer et accomplir ce qui était prévu avec la création de cette « huile noire » ? Et si l’espèce a changé d’avis au sujet de notre extermination, pourquoi le seul à vouloir encore supprimer la race terrienne est resté endormi sachant qu’il aurait pu partir il y a deux milles ans accomplir son funeste boulot (ce qu’il fait en plus dès qu’il est réveillé) ? Parce que les autres Space Jockeys l’ont mis de force dans un caisson d’hypersommeil pour l’en empêcher mais qu’ils ont tous été tué avant de partir ? Mais surtout pourquoi avoir donné aux hommes préhistoriques l’adresse de cette base cachant des « armes de destruction massive » ? D’autant plus que celles-ci allaient être envoyées sur Terre ?
Il y a un moment où la pratique du tout est mystérieux trouve ses limites. On est au cinéma, pas à la télévision. Un film, même si l’on y prévoit à l’avance des suites, se doit de tenir debout tout seul. Tout expliquer, sûrement pas. C’était même l’un des risques de ce faux prequel mais « vrai remake » qui ne se gène pourtant pas pour ruiner le mystère de la race Space Jockey, et d’une odieuse manière en plus. Mais il y a une très grosse différence entre les zones d’ombres d’Alien par exemple, qui ne concernent que l’aspect des décors du Derelict, très annexes donc à l’histoire centrale et servant « juste » à établir une atmosphère étrange, et les mystères à répétitions de Prometheus qui sont liés intrinsèquement à la narration, voire sont même des enjeux principaux (pourquoi nous ont-ils crée ? pourquoi veulent-ils nous détruire ? pourquoi ont-ils changé d’avis ? Que s’est-il passé sous ce dôme ? Et à quoi sert-il ?).
A l’inverse d’Alien, Prometheus est un film relatant une exploration. Si évidemment toutes les réponses ne peuvent, ni ne doivent être donné, il aurait été bien de lâcher un peu de mou au lieu de nous obliger à attendre une hypothétique suite dans quatre-cinq-six ans qui ne viendra que si le long-métrage est un carton en salle pour comprendre un minimum ce qu’il découvre. En l’état, Prometheus ne raconte rien. Il est pensé en trilogie sans savoir si les deux autres opus seront faits. D’ailleurs on peut même émettre un doute sur ce point sachant comment Lindelof conclut ses scénarios super mystérieux (Lost). En fait, il est vite évident que Lindelof et Scott ne savent pas où ils vont. Ils ne cachent même pas qu’ils n’en ont rien à faire. Après tout, les spectateurs se chargeront de rembourser ce gros objet « hype » plus construit sur un buzz éphémère que sur un solide scénario.
 Sérialisation
Sérialisation
Il s’agit de la nouvelle plaie du cinéma anglophone avec le succès grandissant de leurs séries télévisées populaires et parfaitement ficelées. On fait appel à des scénaristes de séries pour écrire les blockbusters sans qu’ils parviennent à s’adapter au format plus court. Lindelof en est la preuve flagrante mais il n’avait pas été le seul auparavant. La télévision empoisonne de nouveau le cinéma. J.J. Abrams avait déjà amené sa mise en scène télévisuelle à être placée en porte étendard de la réalisation moderne de blockbuster et avait mis à la mode ses ficelles de petits malins visant le prochain rebondissement/twist inattendu plutôt qu’à la cohérence globale du long métrage. Joss Whedon écrivit les Avengers et, outre sa réalisation plate et passe-partout annihilant tout le caractère épique de son sujet, fut incapable de finir son long-métrage sans rajouter une scénette finale faisant office de « to be continued ». Même Steven Moffat (« Sherlock ») avait achevé le Tintin de Spielberg sur une fin ouverte, bien qu’elle soit plus en cohérence de part le sujet du film (Tintin étant une série de bandes dessinées où on suit le duo principal d’aventures en aventures).
Doit-on craindre une « sérialisation » du septième art ? Vaste débat qui n’aura certainement toujours pas trouvé sa réponse dans les années qui viennent, mais on ne peut nier que cela gâche en partie le plaisir que l’on prend devant un long-métrage. S’il est normal de faire en sorte que le spectateur n’ait qu’une envie à la sortie d’un blockbuster (voir immédiatement une suite), il l’est moins de se farcir des demi-films, surtout au prix où coûtent aujourd’hui les places, et de dédouaner un scénariste médiocre qui n’a pas daigné relire sa copie et un studio/réalisateur qui ont immédiatement approuvé ce script incohérent plein de trous sous prétexte qu’on aura (peut-être) des explications plus tard. Ne pas savoir d’où vient le Space Jockey dans Alien est une chose (surtout qu’il n’apparait au plus qu’une minute) ; ne pas savoir pourquoi ils veulent détruire l’Humanité en est une autre alors que c’est la raison principale de la mort de la quasi-totalité de l’équipage dans Prometheus.
Prometheus se finit au moment où le film ne fait que commencer. Au moment où Shaw fait son premier choix autonome afin de trouver sa réponse. Mais c’est tellement mieux d’avoir un long-métrage qu’avec des questions sans réponse ! Ca donne l’impression que le film est intelligent et ça fait jubiler le public geek qui passera les cinq prochaines années à élaborer des théories farfelues pour expliquer telles incohérences ou trous scénaristiques balancés à l’arrache afin de s’auto-convaincre que le « méga film évènement qui va ressusciter la S.F. » n’est pas un gigantesque étron. Cette même communauté « geek » qui se plait à descendre Avatar sous prétexte qu’il est destiné aux enfants pour ensuite élever Prometheus au rang de grand film parce que c’est sombre et violent. Cette comparaison est pourtant tout le temps en défaveur du film de Scott. Même au niveau de la 3D, il ne lui arrive pas à la cheville (elle devient quasiment invisible pendant la seconde heure). On peut reprocher un paquet de choses au script d’Avatar, mais celui-ci est cohérent ; c’est d’ailleurs sa « faiblesse » aux yeux de ses détracteurs qui ne le voient que comme un concentré de clichés et de recettes bien établis. Le scénario de Prometheus est imprévisible pour le coup. Mais c’est parce que les personnages n’ont aucune cohérence et que leurs actions et les évènements qui leur arrivent n’ont aucune répercussion dans les scènes suivantes.
 Sacrifice
Sacrifice
Au final, Prometheus c’est surtout beaucoup de bruit, à l’image de ce très impressionnant crash du vaisseau alien (encore une fois, pris indépendamment, la séquence est assez remarquable). Une scène à ce point bruyante qu’elle est à deux doigts de faire exploser les enceintes des salles de cinéma ; c’est d’ailleurs ce qui est arrivé lors de la première projection presse mondiale à Paris. On surligne le tout avec des effets visuels à gogo et des décibels à rendre sourd le spectateur le plus au fond de la salle afin de l’anesthésier et lui rendre « invisible » les innombrables scories du scénario. Là encore, dans ses plus gros moments de bravoure, Prometheus ne se donne même pas la peine de ne pas se moquer du spectateur. Le trio de pilotes kamikazes du Prometheus part se suicider en levant les bras, sous une musique patriotique et à coup de « lens flares », afin d’abimer le vaisseau du méchant alien (qui démarre à l’aide d’une flute !) et l’empêcher de détruire la Terre tandis que les deux héroïnes fuient le vaisseau qui se crashe en courant bien dans son axe pour se faire écraser. Tout ça parce que Shaw leur a demandé de se donner la mort.
Les mercenaires ne rechignent pas, d’autant plus que deux d’entre eux auraient pu avoir la vie sauve. On fait deux ou trois vannes pour dédramatiser la situation puis on va gaiment mourir comme si on était à Space Mountain. Consternant. Reste évidemment le climax final. Qui dure trois minutes à tout casser dans lesquelles Scott et Lindelof arrivent quand même à placer un paquet d’incohérences. Shaw fait au moins deux cents mètres en rampant en moins de deux minutes (ce qui lui reste d’oxygène dans son scaphandre). A noter qu’après sa césarienne, les agrafes tiennent visiblement très bien puisqu’elle peut sauter, courir et se blesser sans que cela entraine de complications. Le Space Jockey qui a survécu au crash court à l’air libre sans son casque pachydermique ; ça valait le coup de terraformer le dôme. Paul le poulpe revient sous le format « big size » car il a bien grandi pour une bestiole enfermée dans une petite salle stérilisée.
A peine le géant menaçant a-t-il le temps de foncer droit sur Shaw (Scott ne connait plus le suspense) que dix secondes plus tard il se fait attraper par un Cthulhu du pauvre. A cet instant, le spectateur se sent un peu comme ce Space Jockey obligé à faire une sorte de fellation à ce poulpe-facehugger géant. Car twist évidemment : ce poulpe est une version géante et antérieure aux fameux « facehuggers » qui s’accrochent comme un parasite au visage d’un être vivant pour lui inséminer un embryon dans la cage thoracique. Et Scott de faire un doigt d’honneur cinématographique au public en montrant Shaw qui quitte cette planète funeste avec, sous le bras, la tête restante de l’androïde qui a tué son petit ami et l’a engrossé sciemment d’un extraterrestre gluant. Dans un autre vaisseau de Space Jockey, elle annonce qu’elle part toute seule et sans arme non pas sur Terre pour alerter l’humanité de la menace mais sur la vraie planète de leurs créateurs géants et belliqueux pour leur demander des explications. Bravo ma grande ! Au moins le deuxième épisode ne devrait pas avoir une durée excédant trois minutes à moins que tu n’arrives sur cette planète que dans le troisième épisode.
 Destruction
Destruction
Et au moment où on croit que c’est enfin terminé, Scott achève son public avec une séquence gratuite sous la forme d’un second doigt d’honneur encore plus révoltant. Une apparition d’un proto-Alien ridicule tellement insultante qu’elle ne peut avoir été envisagée au premier degré. Une scène gratuite, sans aucun sens sachant que Shaw a quitté la planète et n’ayant que l’unique but de faire jouir la « fan base » geek. On frise l’escroquerie en bande organisée. Ce qui est véritablement scandaleux c’est d’abord le fait qu’un nombre incommensurable de projets filmiques audacieux « pour adultes » a été annulé par des studios frileux au cours des 110 années précédentes et qu’on permette ensuite à cette production indigne et lamentable d’être le film « R » le plus cher et ambitieux de l’histoire du cinéma. Ce qui est aussi scandaleux, c’est que cette bouse minable empêche Guillermo Del Toro de se lancer dans son adaptation rêvée des « Montagnes hallucinées » aux côtés de James Cameron et de Tom Cruise puisque Scott vient de lui couper l’herbe sous le pied (inutile de dire que le film de Del Toro aurait eu infiniment plus de gueule).
Prometheus est l’un des space opera les plus embarrassants jamais réalisé. L’un des blockbusters les moins bien écrits de ces dernières années. Un film applaudi pour sa production design alors qu’il se contente de placer ce qui n’avait pas été utilisé dans Alien. Un « film écologique » en somme. Un film qui sous couvert d’être classé « R » a malgré tout enlevé presque toute la charge érotique des dessins de « Metal Hurlant » qu’il repompe sans vergogne. Un pitoyable remake d’Alien dont il reprend la structure narrative et les rebondissements tout en leurs faisant perdre leurs forces et leurs viscéralités. Une bondieuserie consensuelle insupportable faisant l’apologie du créationnisme et de l’importance de croire (« j’y crois parce que j’ai choisi de le croire » remporte la palme de la phrase « nanarde » de 2012) tout en empruntant une symbolique majoritairement chrétienne en rassurant les intégristes religieux de la « Bible Belt » sur le fait que de toute façon il y a bien quelque chose d’autre qui a crée nos créateurs. Un long-métrage opportuniste à 150 millions de dollars dont le scénario a été co-écrit avec Lindelof probablement en état d’ébriété (dixit fièrement ou puérilement Scott dans son interview dans « Le Nouvel Observateur »).
Ridley Scott vient de lancer une trilogie prequel aussi passionnante et réussie que George Lucas en 1999 avec La Menace Fantôme. Il ne reste qu’à espérer qu’il ne copiera pas son modèle en retouchant son œuvre originale de 1979 pour la faire concorder avec sa prequel pathétique (les incohérences de design sont aussi légions). En attendant, il envisage de saloper son second chef d’œuvre Blade Runner en lui affublant une sequel toute inutile. Il compte y faire revenir Harrison Ford afin de répondre enfin à la question de la nature du personnage de Deckard (humain ou replicant ?) et vient d’annoncer qu’il envisage déjà d’y mettre les scènes qu’il n’avait pas inclus dans son film de 1983. Une impression de déjà vu ? Souvenez-vous de Prometheus lorsque vous découvrirez les premiers teasers super excitants et esthétiques de Blade Runner 2 : les chances pour que ce second retour en arrière soit d’anthologie sont devenues scientifiquement nulles depuis ce funèbre jour du 30 mai 2012.
NOTE : 2,5 / 10


 Sauvetage
Sauvetage Rétro
Rétro




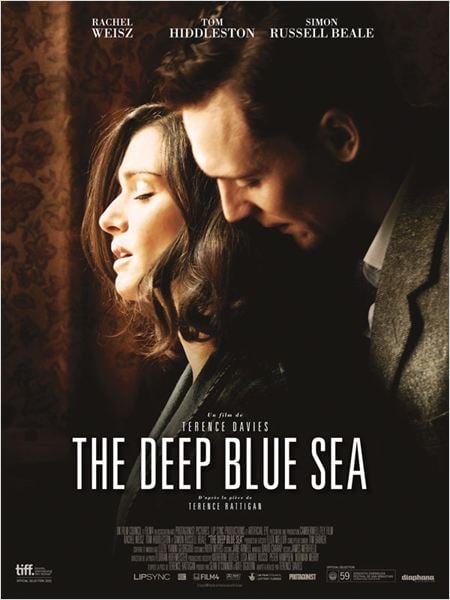
 Passion enflammée
Passion enflammée Libération
Libération
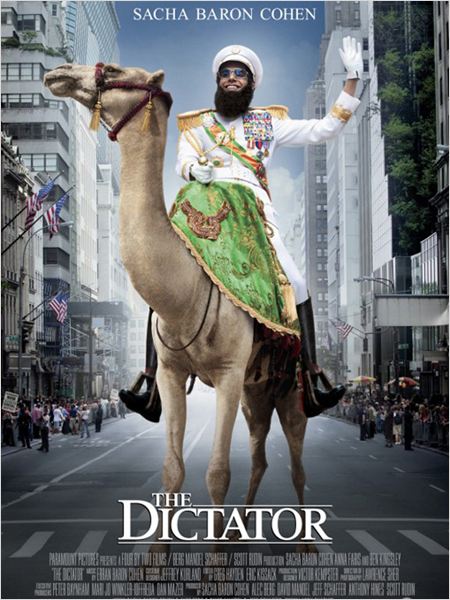
 Rébellion
Rébellion Démocratisation
Démocratisation Pacification
Pacification

 Miroir, mon beau miroir
Miroir, mon beau miroir Sommeil éternel
Sommeil éternel Qui est la plus belle ?
Qui est la plus belle ? Emprunt à taux variable
Emprunt à taux variable
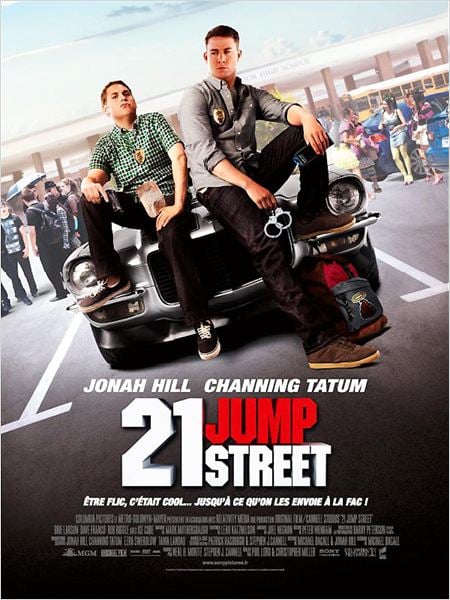
 Petite lucarne et grand écran
Petite lucarne et grand écran Stéréotypes
Stéréotypes Liaison covalente
Liaison covalente High School Comedy
High School Comedy

 Alien Résurrection
Alien Résurrection Cycle de la vie
Cycle de la vie Morcellement
Morcellement Incohérences
Incohérences Infantile
Infantile Briser la suspension d’incrédulité
Briser la suspension d’incrédulité Mutation
Mutation Naissance
Naissance Réapparition
Réapparition Hubris
Hubris Trous noirs
Trous noirs Sérialisation
Sérialisation Sacrifice
Sacrifice Destruction
Destruction
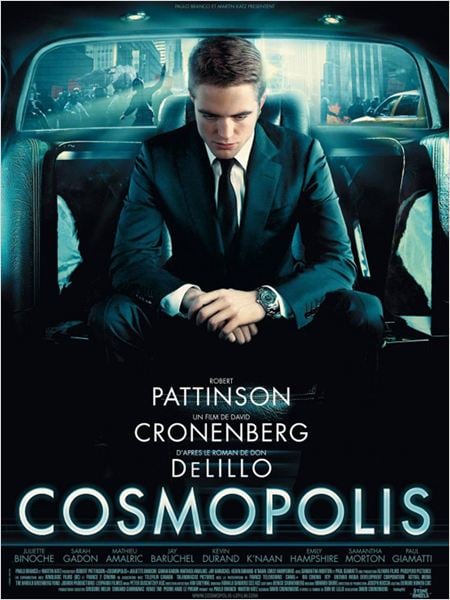
 Chute
Chute Rat mort
Rat mort ‘Un spectre hante le monde’
‘Un spectre hante le monde’ Pénétration
Pénétration Pulsion de mort
Pulsion de mort Asymétrique
Asymétrique ‘Everybody wants to live’
‘Everybody wants to live’ Le roi et le fou
Le roi et le fou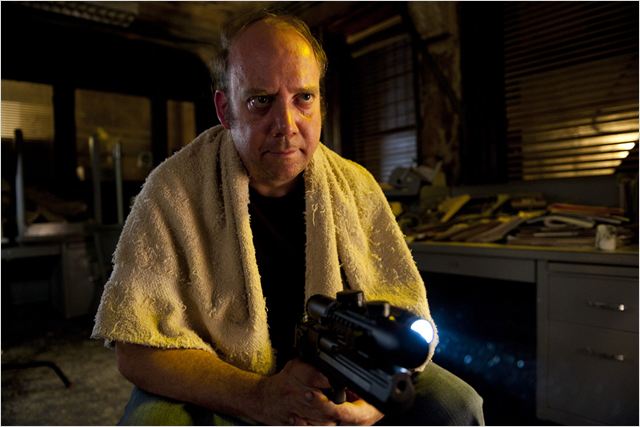 Symptôme
Symptôme
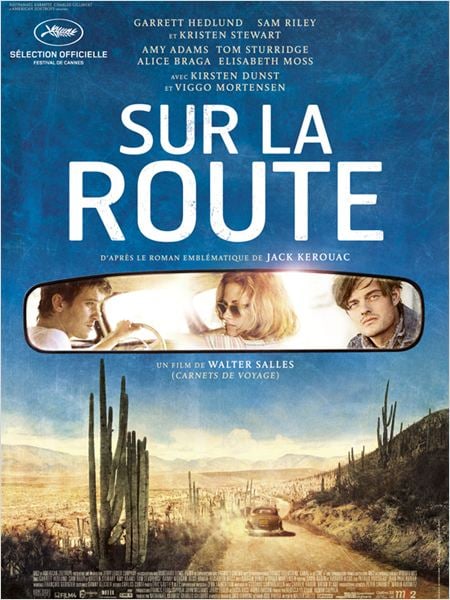
 Voyage dans le temps
Voyage dans le temps Combustion instantanée
Combustion instantanée
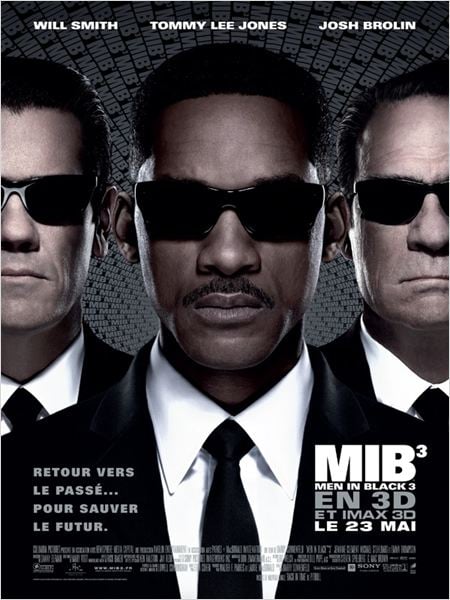
 Bazar temporel
Bazar temporel Absence
Absence Lier n’est pas jouer
Lier n’est pas jouer Point de non-retour
Point de non-retour

 Contrainte étouffante
Contrainte étouffante Roméo et Juliette Junior
Roméo et Juliette Junior eux d’enfants
eux d’enfants Le vent se lève
Le vent se lève
/image%2F0568383%2F20140204%2Fob_e6c6b1_img-17513182416006.jpeg)